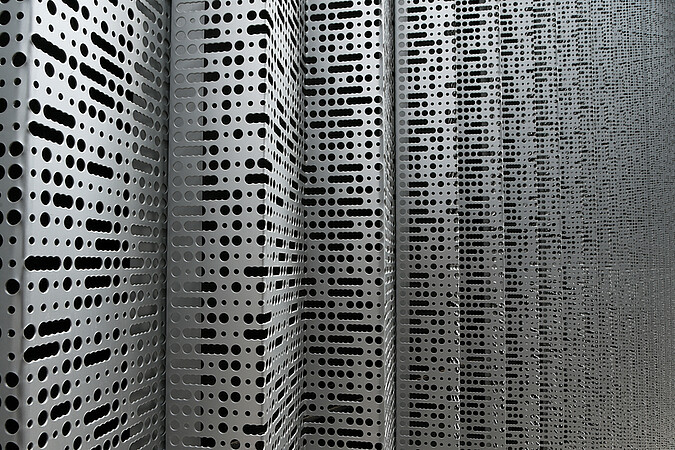« La dette publique est un instrument politique »
Bien souvent présentée comme faramineuse, une charge pour l’État et ses citoyens, la dette française a-t-elle véritablement atteint un point de non-retour ? Dialogue entre deux économistes du Bureau d’économie théorique et appliquée (Beta - Unistra/CNRS/Université de Lorraine/Inrae) et enseignants à la Faculté des sciences économiques et de gestion (Fseg), Moïse Sidiropoulos, macroéconomiste, et Francis Munier, spécialiste de l’économie du bonheur.
115 % du PIB, 3 200 milliards d’euros, 5 000 €/seconde… Les indicateurs sont-ils au rouge pour la dette française ?
Francis Munier : Ces chiffres indiquent un niveau élevé mais certainement pas une potentielle faillite. La France emprunte toujours à des taux raisonnables nonobstant la dégradation récente de ses notes par des agences de notation – à mon sens, expliquée davantage par l’instabilité politique que par le niveau proprement dit de la dette.
Moïse Sidiropoulos : Le remboursement des intérêts est devenu le premier poste de dépense de l’État, avec un coût doublé entre 2020 et 2024. C’est inédit, alors que la France s’endette pour couvrir ses déficits depuis les années 1970. Les responsables publics ont aussi sous-estimé l’impact du vieillissement, dans un pays où la protection sociale représente 46 % des dépenses publiques, dont plus de la moitié pour les retraites. Le tout s’inscrit aux côtés d’un déficit extérieur chronique et d’une désindustrialisation continue depuis les années 1980.
Quels sont les risques ?
M. S. : Dans l’Union européenne, un défaut français ferait vaciller la monnaie unique. Le risque est réel, si le « spread » (différence de taux d’intérêt) avec l’Allemagne continue de grandir. La Banque centrale européenne (BCE) pourrait alors imposer des mesures d’austérité, comme en Grèce. Depuis les crises de 2020, la BCE a racheté un quart de la dette française – une situation exceptionnelle, tous les États de la zone euro étant alors en difficulté – qu’elle ne reproduira pas.
F. M. : À nouveau, il ne faut pas surestimer la menace car ce sont les intérêts qu’il faut rembourser, pas la dette elle-même. L’État est pérenne et en cela toute comparaison avec un ménage est fallacieuse.
M. S. : Je serais moins optimiste : dans un contexte de faibles croissance et inflation, la soutenabilité de la dette est incertaine.
Faut-il revoir les règles européennes ?
M. S. : Oui. Le Pacte de stabilité et de croissance, issu du traité de Maastricht (1992, lire encadré), reposait sur une croissance à 5 %. Il est mécaniquement inadapté aujourd’hui.
F. M. : Oui, le dernier rapport Draghi appelle à davantage de fédéralisme, pour une politique budgétaire commune renforcée. Une position cohérente avec le « quoi qu’il en coûte ». Rappelons que la règle des 3 % de déficit public en fonction du PIB n’est pas fondée économiquement.
Tout serait donc question de volonté politique ?
M. S. : Absolument. Depuis 2022, la montée des taux d’intérêts résulte d’un cercle vicieux : instabilité gouvernementale, tensions entre exécutif et Parlement, blocage budgétaire. La France inspire moins confiance et emprunte plus cher. Cette situation politique incertaine joue un rôle croissant dans la perception et la performance de l’économie française.
F. M. : La dette résulte aussi des choix politiques. Le fait de recourir aux marchés financiers, ce n’est pas neutre : c'est une loi de 1973 qui impose de financer la dette publique via les marchés financiers. Le fait d’interdire la création monétaire pour financer la dette, d’enchaîner les privatisations et de donner des aides publiques sans conditions a affaibli l’État, tout en profitant surtout au secteur financier. Cette donne s’est inspirée des idées monétaristes, dans un contexte de forte inflation, consolidé par les traités européens.
« Robert Schiller avance la notion de “narrative economics”, où les discours comptent autant, voire plus, que les modèles économiques »
La question des récits est également centrale : parler de « pronostic vital », d’un « pays en faillite », ce n’est à nouveau pas neutre. Robert Schiller avance la notion de narrative economics, où les discours comptent autant, voire plus, que les modèles économiques. David Graeber rappelle que la dette est une construction sociale, un outil politique, elle doit être gérée, et non pensée uniquement en termes moraux.
M. S. : Oui, les récits influencent. Alors Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin appelait en 2003 à gérer la France « en bon père de famille » : une confusion, car un État n’est pas un ménage et n’a pas les mêmes contraintes de remboursement.
Que faudrait-il faire, alors ?
F. M. : Pour favoriser une dynamique de reprise, il faut considérer la dette comme un investissement qui favorise la croissance et donc la capacité future de remboursement.
Comme je l’indique dans mon article « Et si la dette publique servait d’abord à rendre les citoyens plus heureux ? », la dette publique ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme un outil potentiellement utile si l’argent emprunté sert à financer des services publics et des politiques de bien-être : santé, éducation, transition écologique, etc. L’accroissement du bonheur des citoyens devrait être la boussole des politiques économiques.
M. S. : Les dépenses sociales représentent 32,3 % du PIB, davantage que la moyenne européenne (26,5 %). Elles doivent être réduites. Pour autant, je trouve que la vision proposée par l’économie du bonheur mérite d’être considérée.
Des indicateurs en trompe-l'oeil
Les indicateurs de l’économie européenne ont été adoptés dans un contexte qui n’est plus du tout le même, rappellent les deux économistes.
Parmi les critères de Maastricht, conditionnant la participation d’un Etat à la zone euro :
- Le déficit de l’administration publique ne peut dépasser 3 % du PIB
- La dette publique (= cumul des déficits) ne peut dépasser 60 % du PIB. Depuis les années 1980, les Etats s’endettent via l’émission d’obligations, vendues sur le marché financier mondialisé.
En savoir plus sur les critères de Maastricht
Dans un influent article de 2010, les économistes Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff (Université Harvard) affirmaient avoir établi une relation empirique forte entre une dette supérieure à 90 % du PIB et une croissance négative. Cette idée devient un argument pour justifier l’austérité budgétaire après la crise financière. En 2013, Thomas Herndon, étudiant en thèse, réplique leur étude et découvre une erreur de formule Excel excluant plusieurs pays, une sélection arbitraire des données et un choix contestable de pondération, donnant trop de poids à certains cas extrêmes. Une fois corrigées, les données montrent qu’il n’existe pas de « seuil magique » ou de corrélation, entamant la crédibilité des arguments pro-austérité.
Mots-clés
Mots-clés associés à l'article :