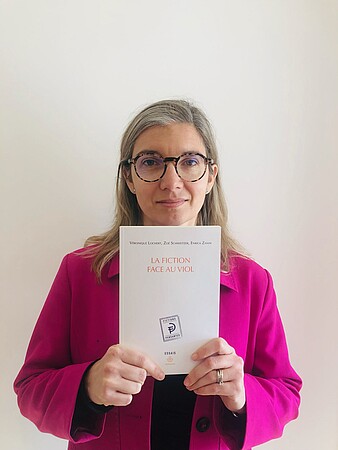Le viol dans la littérature et au théâtre, une évolution des représentations
Rarement condamné sous l’Ancien régime, sujet tabou, le viol est pourtant très présent dans la fiction, de l’Antiquité à nos jours. Véronique Lochert, Zoé Schweitzer et Enrica Zanin, chercheuses en littérature comparée, se sont penchées sur la question dans leur ouvrage « La Fiction face au viol », paru aux éditions Hermann. Le point avec Enrica Zanin, enseignante-chercheuse au sein de l'Institut thématique interdisciplinaire (ITI) Lethica (Littératures, éthiques et arts).
Pourquoi ce sujet ?
Il y a beaucoup de publications autour de la question du viol qui tendent à condamner les textes du passé comme expression de la « culture du viol », nous avons voulu vérifier. Notre idée est que les représentations du viol changent avec le temps, et que le passé a beaucoup à nous apprendre sur le viol et ne se limite pas à véhiculer une culture du viol. Pour cela, la littérature est un bon point d’entrée. Les textes fonctionnent comme des sismographes, en décrivant les sensibilités d’une époque et leurs évolutions. Ils permettent aussi de critiquer les a priori convenus, voire d’imaginer et de tester des représentations du viol en avance sur leur temps.
Quelle est votre méthodologie ?
Dans cet ouvrage, nous sommes dans une logique d’anachronisme contrôlé : comment une notion contemporaine raisonne au contact de textes anciens ? En appliquant notre regard et la définition actuelle du viol (« un acte de pénétration sexuelle, commis par violence, contrainte, menace ou surprise », selon l’article 222 du code pénal) à certains textes, nous voyons apparaitre des viols là où il n’y en avait pas pour l’époque.
Comment se construit l’ouvrage ?
Nous allons de l’Antiquité à nos jours, en étudiant les œuvres de la littérature occidentale. Une première partie, « Le viol, une fiction impossible ? », porte sur le théâtre, et se demande s’il est possible – et le cas échéant par quels moyens – de représenter le viol. Une seconde partie traite du viol de la nouvelle au roman. Une troisième s’intéresse aux réécritures de l’histoire de Philomèle, racontée par Ovide.
La violence extrême de cette histoire tend à être atténuée par la suite
Violée par son beau-frère qui lui coupe la langue pour qu’elle ne puisse pas témoigner, elle brode son histoire sur une toile qu’elle fait envoyer à sa sœur qui la croyait morte. Cette dernière venge sa sœur en tuant son propre fils et en le donnant à manger au violeur, son mari. La violence extrême de cette histoire, bien présente dans ses réécritures à la Renaissance, tend à être atténuée par la suite, en effaçant le rôle de la victime et l’horreur du crime qu’elle a subi pour ne pas « choquer » les lectrices et lecteurs.
Quel constat faites-vous ?
Le périmètre du viol n’est pas le même dans le passé qu’aujourd’hui. De nos jours, le consentement est une notion importante. Dans l’Antiquité et à la Renaissance, seule la violence définit le viol qui est, par ailleurs, rarement mentionné en tant que tel. Selon la physiologie de la Renaissance, même si une femme dit non, son corps peut éprouver du plaisir lors d’un viol. On supposait en effet que pour concevoir un enfant, il fallait que la femme jouisse. Si une femme violée tombait enceinte, c’est donc que son corps était d’accord…
Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Dans les cents nouvelles du Décaméron, que Boccace écrit vers 1350, a priori, il y a beaucoup de sexe, mais pas de viol. Toutefois, si on définit le viol selon les termes actuels du code pénal, 21 scènes de viol apparaissent. Un exemple fréquent est ce qu’on appelle le « bed trick » : la nuit, dans l’obscurité, un autre homme se glisse dans le lit d’une femme en se faisant passer pour son mari – la nuit se passe en caresse et ce n’est qu’au réveil que la femme (ou son mari) comprend ce qui s’est passé… la femme semble plutôt satisfaite de sa nuit et l’offensé, selon les codes du temps, est plutôt le mari. Les nouvelles donnent ainsi à voir des viols invisibilisés, sans violence, transformés en objet comique. Le rire qu’ils provoquent est pourtant grinçant : le lecteur est gêné et invité à comprendre ce que Boccace entend dénoncer par le viol – la violence endémique des liens sociaux, l’immoralité de la société et du clergé.
Au début 18e siècle, le code pénal considère le viol seulement comme un abus physique
Plus tard, au 16e siècle, Marguerite de Navarre met en scène, dans L’Heptaméron, des hommes qui parlent du viol selon les clichés sexistes du temps : mais c’est pour déconstruire leur discours et en dénoncer la violence tacite. Avec l’essor du roman, au début du 18e siècle, alors que le code pénal considère le viol seulement comme un abus physique, la littérature donne à voir ses séquelles psychologiques : dans Clarissa, roman épistolaire de Samuel Richardson, l’héroïne est droguée et violée. Si l’évènement n’est pas décrit, son traumatisme psychologique ressort dans ses lettres, car elle divague et ne semble plus savoir écrire.
Différents évènements autour de la thématique
- Ouvrage - Un nouvel ouvrage des mêmes autrices, intitulé Scènes de viol, est prévu pour le printemps au éditions Hermann. Il traitera du viol au théâtre.
- Colloque – Un colloque intitulé « "Elle s’abandonna". Représentation de l’acte de céder dans la littérature du 19e siècle », a été organisé les 4 et 5 mars autour de la thématique du consentement.
- Journée d’études - Une journée d’étude est prévue le 10 juin sur le thème de l’inceste. « Actualités des récits d’inceste (1986-2025) enjeux génériques, médiatiques et éthiques. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de L’ITI Lethica
Mots-clés
Mots-clés associés à l'article :