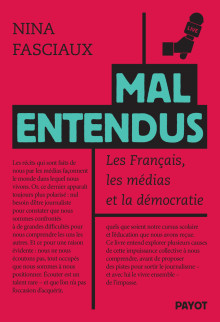« L’information n’appartient pas aux journalistes »
S’ouvrir davantage à la cité : dans la droite ligne du nouveau souffle impulsé par son tandem dirigeant, le Centre universitaire d’enseignement du journalisme (Cuej) de l’Université de Strasbourg invite à faire réfléchir ensemble grand public et professionnels des médias sur le traitement médiatique. Début juin, une table ronde a questionné le sujet de l’environnement, d’une brûlante actualité. Charlotte Dorn, directrice adjointe depuis septembre 2024, porte ces questions au sein de l’école.
Que s’est-il passé le 3 juin dernier au Cuej ?
Nous avons organisé une après-midi et une soirée dédiées à la couverture des enjeux environnementaux, avec l’association alsacienne Hop La Transition. Les ateliers de sensibilisation pour les journalistes, sur la biodiversité, l’eau, la mobilité et les énergies, ont mobilisé moins qu’espéré dans les grandes rédactions, mais nous avons eu la satisfaction de réunir des professionnels de toutes générations. La table ronde du soir, sur le thème « Enjeux environnementaux : que peuvent les médias locaux ? » a rassemblé largement et généré beaucoup de questions. C’est exactement ce que nous cherchons à faire depuis le début de l’année avec Cédric Pellen, directeur du Cuej, avec nos conférences, ouvertes sur la cité et permettant à nos étudiantes et étudiants une forte réflexivité sur leur futur métier.
En matière d’environnement, nous nourrissons aussi la réflexion avec de nouveaux cours cette année, comme « Introduction aux transformations environnementales », « Dynamique des controverses scientifiques », ou encore une semaine entière de production dédiée au « journalisme de solutions ». Ils complètent la Fresque du climat, que nos master 2 animent chaque année pour les master 1. Nous préparons aussi des modules de formation continue pour 2026, sur ces sujets, entre autres. L’objectif est clair : former des journalistes non pas militants, mais outillés et crédibles.
« Former des journalistes non pas militants, mais outillés et crédibles »
Pourquoi avez-vous voulu ce format ?
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) le dit : les médias ont un rôle crucial dans la perception et l’action du public face au changement climatique*. Encore faut-il que les journalistes soient formés à ces sujets complexes, puissent maîtriser chiffres, ordres de grandeur, sources, leviers d’action, ce qui n’est pas toujours le cas.
Un journalisme de qualité est indispensable pour restaurer la confiance. L’une de nos invitées de la table ronde, la journaliste et formatrice Nina Fasciaux (lire encadré) l’a souligné : la société civile attend davantage des journalistes sur les enjeux environnementaux. C’est aussi ce que montre l’action de Quota Climat, association fondée par des citoyens pour réclamer davantage de place et de rigueur quant au traitement médiatique de ces sujets.
Vous trouvez que les médias n’ont pas une couverture à la hauteur ?
L’urgence est là, mais certains choix éditoriaux restent frileux. L’ensemble de l’écosystème doit s’emparer de ces enjeux, pas seulement les médias ou les journalistes spécialisés. Depuis 2017-2018, les rédactions y sont plus sensibles, mais parfois pour de mauvaises raisons (course à l’audience, suivisme…), ce que je regrette. Malheureusement, depuis le Covid et la présidentielle de 2022, on note un reflux de la place accordée à ces sujets dans les médias. Mais l’intérêt du public est là : il veut de l’information fiable, chiffrée, traitée avec un angle attractif. Le succès du média Vert, cofondé par Loup Espargilière, alumni du Cuej, le prouve.
Il faut libérer du temps pour que les journalistes se forment, enquêtent, vulgarisent. Le Cuej, parmi les premiers signataires de la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique, se veut être un lieu de réflexion sur le journalisme et ses pratiques, ouvert sur l'extérieur. L’information n'appartient pas aux journalistes.
Nous formons nos étudiants à questionner leurs pratiques, à prendre du recul, pour qu’ils emportent cette culture dans les rédactions. Cela passe par les fondamentaux : vérification, rigueur, sortie du clash et de la polarisation. On a besoin de retrouver de la complexité et de la nuance.
« La “culture du clic” ne peut pas être l’indicateur d’un journalisme de qualité : c’est ainsi que l’on construit avec notre audience une relation de confiance, durable et, in fine, que l’on sert la démocratie »
Vous-même, qui avez été journaliste pendant 28 ans aux Dernières Nouvelles d’Alsace avant ce nouveau poste, comment s’est passée la prise de conscience ?
Elle a été progressive mais isolée. Je me suis autoformée, jusqu’à atteindre une forme d’expertise dans ma rédaction sur des questions comme les déchets, les mobilités douces, l’alimentation, la biodiversité, les pollutions... J’aime l’échelon local pour traiter l’information, c’est un prisme passionnant pour relier le quotidien aux grands enjeux globaux.
Documenter ces sujets a influé sur mon propre mode de vie, forcément. Mais la conséquence, c’est que j’ai été perçue dans mon milieu comme une militante, non pas pour ce que j’écrivais, mais parce que je mange végétarien, me déplace à vélo, m’habille de seconde main, etc. C’est dramatique, mais parfois, même dans les rédactions, les faits sont confondus avec l’opinion.
Que l’on relate un incendie ou une inondation, il faut revenir sur le terrain, expliquer les causes, ouvrir les perspectives. La « culture du clic » ne peut pas être l’indicateur d’un journalisme de qualité : c’est ainsi que l’on construit avec notre audience une relation de confiance, durable et, in fine, que l’on sert la démocratie.
* 6e rapport (mars 2021) du Giec
- Lire aussi : Centre universitaire d’enseignement du journalisme : un espace en réflexion
- (Re)voir la table ronde « Enjeux environnementaux : que peuvent les médias locaux ? »
Du rôle du journaliste comme « facilitateur de dialogue »
Journaliste et formatrice auprès des professionnels des médias au sein du Solutions Journalism Network, dont elle est responsable en Europe, Nina Fasciaux est autrice du livre Mal entendus, les Français, les médias et la démocratie, sorti en janvier 2025.
Face à l'urgence d'apaiser le débat national, ultrapolarisé, elle en appelle à la responsabilité des journalistes à se recentrer sur leur rôle de médiation, d'écoute, de facilitateurs de dialogue et créateurs de liens
, afin de démêler un immense malentendu qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne s'écoute. Les récits qui sont faits par les médias façonnent le monde dans lequel nous vivons. Il y a urgence
.
Catégories
Catégories associées à l'article :Mots-clés
Mots-clés associés à l'article :